
au delà de cette limite, notre ticket ne va plus être valable
Trois intervenants engagés sur les chantiers de la transition écologique ont accepté d’échanger autour de ces enjeux. Sans langue de b...
Notre expertise

Trois intervenants engagés sur les chantiers de la transition écologique ont accepté d’échanger autour de ces enjeux. Sans langue de bois, Jérôme Perez (Global Head of sustainability chez Nespresso), Jean Vigneron (directeur industriel et RSE chez Maped-Juratoys) et Jonathan Normand (CEO de la fondation B-Lab Suisse) ont partagé leurs parcours, les difficultés, injonctions contradictoires et dilemnes auxquels ils doivent faire face dans la mise en oeuvre de leurs ambitieux programmes et leurs expériences concrètes sur ce chemin de transformation. Le débat a permis d’illustrer concrètement la complexité du sujet, au-delà des grands titres et effets d’annonce.
Jonathan Normand

Papa de trois filles, Jonathan débute sa carrière à 18 ans à l’OMS à Genève, avant d’être débauché par Electronic Data Sytem qui l’envoie à Houston puis Dallas et l’amena à beaucoup voyager en dehors des USA.
Retour en Suisse quatre années plus tard, début de son implication dans le secteur bancaire sur les volets ESG et Compliance auprès de la banque privée Constant. Retour aux USA pour Reuters avant de revenir à Genève pour l’UBP.
Démarrage dans le conseil en 2008 avec la création du cabinet Codetic à Genève autour des enjeux de gouvernance et responsabilité sociale notamment. Rencontre avec B Lab en 2011 et co-fonde l’antenne de l’ONG B-Lab Europe en 2012. Revente de Codetic en 2015 pour se consacrer à 100 % à B Lab Switzerland dont Jonathan est le CEO et fondateur.
Jonathan se ressource en famille, dans la nature et notamment en montagne.
Jérôme Perez
Papa de deux enfants, et d’un adorable chien, Jérôme est originaire du Sud de la France.
Global Head of Sustainability chez Nespresso HQ, marque Suisse que l’on ne présente plus.
C’est en direct du siège de Vevey en Suisse, qu’il est chargé
de définir et mettre en œuvre
la strat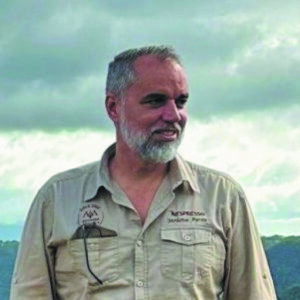 égie globale de durabilité de l’entreprise. Avant de rejoindre Nespresso en 2008, Jérôme a occupé divers postes chez Nestlé Waters, notamment en tant que directeur du contrôle financier en France
et en Belgique.
égie globale de durabilité de l’entreprise. Avant de rejoindre Nespresso en 2008, Jérôme a occupé divers postes chez Nestlé Waters, notamment en tant que directeur du contrôle financier en France
et en Belgique.
Jérôme porte avec ses équipes, et des convictions inébranlables, la stratégie et le développement de la durabilité Nespresso lui permettant ainsi de faire de son entreprise l’une des plus grandes à être certifiée B Corp.
Jean Vigneron

Papa de quatre filles, Jean est un ancien du Groupe Alstom pour lequel il participa à son expansion en Corée du Sud comme responsable technique du TGV Séoul-Pusan et en Chine comme directeur du projet de la ligne 3 du métro de Shanghai.
En 2003, Jean rejoint Maped alors dirigé par Jacques Lacroix pour piloter la Chine, où il a très significativement contribué au développement de l’entreprise par la construction d’un site industriel de 4 0000 m2 et sa forte automatisation permettant ainsi à Maped de rester compétitif face à la concurrence internationale.
Jean est depuis 2021, le directeur industriel, qualité et RSE du groupe Maped-Juratoys, entreprise familiale leader mondial des instruments d’écriture scolaire, également un des leaders européens du jouet.
_
Des trajectoires personnelles à la mise en mouvement
Jérôme évoque ses rencontres avec des producteurs de café frappés de plein fouet par le changement climatique : « Quand on vous dit qu’il n’y a plus de saison pour planter, vous ne pouvez plus rester dans l’ancien modèle. » Ce sont ces moments concrets, vécus sur le terrain, qui l’ont poussé à refonder la manière dont Nespresso pense sa chaîne de valeur.
Jonathan raconte sa transition du monde associatif à la fondation de B Lab Europe, mû par le besoin de dépasser l’opposition entre performance économique et responsabilité sociétale : « Je ne voulais plus choisir entre les deux. Il fallait créer une troisième voie. » Cette troisième voie, il l’a incarnée dans les statuts des entreprises à mission et la certification B Corp.
Jean, ingénieur de formation, décrit un basculement plus progressif. C’est en confrontant les impératifs industriels aux nouvelles exigences réglementaires qu’il a vu la nécessité de changer les pratiques à l’échelle du système productif. Pour lui, « on ne peut plus piloter une entreprise sans intégrer la durabilité dans les décisions stratégiques. »
_
Gouvernance : aligner les structures et les intentions
Le débat s’oriente vers les difficultés structurelles que rencontrent les entreprises pour traduire l’intention en gouvernance réelle. Jonathan insiste sur la nécessité d’aligner statuts, stratégie et gouvernance : « Ce n’est pas du vernis, c’est un socle. Une entreprise à mission doit repenser qui siège au conseil, comment on décide, sur quoi on rend des comptes. »
Jean insiste sur la temporalité du changement : « Il faut accompagner la montée en compétences, former les équipes, faire évoluer la gouvernance ». Il partage des exemples concrets pour changer l’ADN de l’entreprise : modification des fiches de poste de l’ensemble du personnel de l’entreprise et intégration de critères RSE dans les primes sur objectifs en commençant par le Codir. La RSE doit être une mise à jour cohérente du logiciel de l’entreprise, du conseil d’administration à l’ouvrier sur le terrain.
Jérôme parle de cohérence au long cours : « On ne change pas tout du jour au lendemain. Mais on peut faire émerger des poches de transformation. Des territoires d’expérimentation. » Il décrit un travail patient, itératif, qui passe aussi par la mobilisation d’alliés internes.

_
Indicateurs, mesure et récits de l’impact
Mesurer l’impact est devenu central, mais nos invités en soulignent les limites et les tensions. « Si on mesure sans incarner, on déshumanise. Et si on raconte sans preuve, on perd en crédibilité », résume Jonathan. Pour lui, les indicateurs doivent être reliés à un récit plus global de transformation.
Jean souligne l’accélération des exigences européennes, notamment avec la CSRD : « Nous allons devoir publier des données extra-financières auditées. C’est un saut culturel énorme pour beaucoup d’entreprises. » Il alerte sur le risque de produire des reportings qui épuisent les équipes sans transformer par l’action qui donne du sens.
Jérôme revient à la réalité du terrain : « La résilience, ça ne se mesure pas uniquement avec des tableaux. Ça se vit sur le terrain, dans la manière dont une communauté tient debout malgré les chocs. » Il défend une approche qualitative, basée sur le lien humain et l’observation.
_
Travailler sous contraintes fortes et dans l’incertitude
Une conviction réunit nos invités: la transformation durable exige une navigation constante entre tensions souvent contradictoires. Tensions entre court terme et long terme, entre attentes sociales et impératifs économiques, entre normes globales et réalités locales.
Jonathan rappelle que « ce n’est pas un projet de communication, c’est une réforme en profondeur du contrat social entre les entreprises et la société. » Jean insiste sur l’importance d’agir sans attendre d’être parfait : « Nous n’aurons jamais toutes les réponses. Mais nous avons la responsabilité de mettre en mouvement l’intelligence collective dans les services à fort impact sur la performance RSE. » Et Jérôme poursuit : « Ce qui compte, c’est de durer. De tenir dans la cohérence. D’inspirer les autres, sans arrogance. »
Jérôme insiste sur l’importance de la mise en récit pour entraîner les équipes dans une dynamique de sens. Il raconte comment certaines présentations faites au comité exécutif ont changé d’impact dès lors qu’elles étaient portées par des témoignages de terrain : « Quand vous faites venir un producteur sur scène, que vous voyez ses mains, ses rides, ses choix, alors on ne peut plus gérer cela comme une ligne de reporting. » Ce travail d’humanisation de la donnée est au cœur de son action.
De son côté, Jonathan alerte sur la fatigue narrative : « Les collaborateurs n’adhèrent plus à des slogans génériques. Ils veulent de la vérité, de l’émotion, et des actes. » Il appelle à une pédagogie du doute et de l’imperfection. Pour lui, l’entreprise engagée ne se définit pas par son bilan parfait, mais par sa capacité à progresser, à reconnaître ses limites et à partager ses vulnérabilités.
Jonathan évoque les expériences de sociétés B Corps où le conseil d’administration inclut des parties prenantes externes : salariés, ONG, clients. « Cela change tout : les décisions stratégiques ne sont plus auto-référentielles. Elles sont ancrées dans des écosystèmes. » Il milite pour une gouvernance dans le dialogue, ouverte et responsable.
Jean partage l’idée d’un audit inversé : « On a invité des jeunes salariés à auditer les pratiques managériales en matière d’écologie. Leurs retours ont été décapants. Mais c’était nécessaire. » Ce renversement de posture a permis de faire émerger des angles morts et d’être plus exigeant dans la démarche RSE.
Jérôme met en garde contre l’obsession de la preuve chiffrée : « À vouloir tout traduire en % de réduction, on oublie que l’impact est aussi relationnel, émotionnel, collectif. » Il plaide pour une approche hybride, croisant indicateurs quantitatifs et récits qualitatifs, ancrés dans l’expérience humaine.
Jonathan rappelle que le but de la mesure n’est pas seulement d’informer, mais de transformer. Il évoque l’exemple d’une entreprise qui a redéfini ses bonus de direction non plus sur la seule base de la performance financière, mais aussi sur l’évolution de ses indicateurs climat et inclusion. « Là, on entre dans du sérieux. »
La discussion se porte sur l’appel à tenir la complexité. Les intervenants ne prétendent pas avoir toutes les réponses, mais ils appellent à la responsabilité partagée. « Ce qui nous lie, ce n’est pas la certitude, c’est le courage d’essayer », résume Jonathan.
Jérôme rappelle que la durabilité ne se décrète pas, elle se prouve chaque jour dans les choix, les arbitrages et les renoncements. « On ne peut pas être parfaits. Mais on peut être cohérents, sincères, et contagieux. »
Au fil des échanges, une idée revient avec force : la durabilité est un engagement qui oblige à réinterroger en profondeur les logiques d’action. Il ne s’agit pas d’ajouter une couche verte ou sociale à une stratégie existante, mais bien de transformer les objectifs mêmes de l’entreprise. Cette reconfiguration touche à la culture, aux modes de pilotage, et à la manière de mesurer la valeur. Les trois intervenants insistent sur la nécessité de dépasser les démarches superficielles et de viser un alignement sincère. Pour Jonathan, cela suppose de reconnaître que l’entreprise n’est pas neutre: elle est porteuse de choix sociaux. Jean ajoute: « On ne peut plus prétendre que la rentabilité seule est un objectif naturel. Les décisions prises doivent aussi maximiser la performance sociétale et environnementale. » Cette lucidité appelle à plus de responsabilité, mais aussi à plus de coopération entre les acteurs économiques. Jérôme abonde en soulignant que le véritable impact ne se décrète pas : il se construit dans les frictions du réel, dans les tensions acceptées, dans la capacité à les dépasser et à durer.
Le rôle des parties prenantes dans les processus de transformation est aussi largement évoqué. Pour Jérôme, l’implication directe des producteurs, des clients, mais aussi des salariés, est fondamentale. « On ne peut pas faire pour eux. Il faut faire avec eux. » Cela suppose des dispositifs de consultation, mais surtout une posture d’écoute et de dialogue. Jean abonde : « On ne change pas une organisation par décret, sans l’accompagner, l’écouter, l’engager dans l’action concrète. »
Jonathan insiste de son côté sur la nécessité d’un cadre normatif solide. Il salue l’émergence de réglementations européennes ambitieuses, mais pointe le risque d’une complexité paralysante pour les PME. « Il faut que ces normes soient accompagnées d’outils pédagogiques. On ne crée pas la transition par la contrainte seule, il faut de la compréhension, de l’appropriation. »
L’interaction entre échelle locale et stratégie globale est également abordée. Jérôme insiste sur l’importance de la granularité : « La transition écologique ne se décrète pas à Vevey. Elle se vit dans les villages producteurs. Si on ne descend pas à cette échelle, on passe à côté. » Jean confirme et évoque l’expérience de ses sites industriels à l’international et les fournisseurs de rang 1, 2 ou 3 qu’il est nécessaire d’accompagner en local permettant ainsi d’enraciner la démarche RSE sur le terrain.
Nous en venons à évoquer la posture du dirigeant engagé. Jonathan appelle à une éthique du doute : « Le dirigeant durable n’est pas celui qui sait tout, mais celui qui accepte de s’exposer, de tâtonner, de reconnaître et expliquer ses doutes, de rendre compte de façon transparente. » Pour Jean, il s’agit de créer une culture du feedback : « Si l’on veut des collaborateurs engagés, il faut qu’ils se sentent autorisés à critiquer, à proposer, à construire. »
Cette exigence de cohérence personnelle revient à plusieurs reprises. Jérôme parle d’alignement intérieur : « Je ne peux pas porter des discours sur la durabilité si je ne suis pas cohérent dans mes actes. » Il évoque aussi les dilemmes : devoir renoncer à certains marchés, résister à des logiques court-termistes, accepter des arbitrages difficiles.
Financement et mesure de la performance.
Sur la question du financement de la transition, les trois intervenants s’accordent sur l’importance de réorienter les flux financiers. « Tant que le coût du capital ne reflète pas les risques environnementaux, on encouragera les mauvais comportements », affirme Jonathan, fort de sa longue expérience dans la finance. Il plaide pour une finance à impact plus exigeante, adossée à des critères transparents et vérifiables. Pour Jean, cet enjeu du financement est crucial mais souligne aussi les freins au changement à ne pas minimiser : « L’offre durable doit être très attractive, sans risque et abordable pour les consommateurs. Un vrai défi pour les acteurs économiques et les gouvernements. »
La formation est aussi un levier central évoqué par tous. Pour Jérôme, il est urgent de former les managers aux enjeux climatiques, sociaux et éthiques. « On ne peut pas diriger un projet durable avec des outils du xxe siècle. » Jean parle d’acculturation progressive, de formation-action, et d’échanges inter-entreprises pour apprendre ensemble. Jonathan ajoute : « Il faut une révolution cognitive dans les écoles de commerce, dans les filières techniques, dans les cercles dirigeants économiques et politiques. »
Les intervenants appellent à une mobilisation collective. « La transition ne se fera pas chacun dans son coin. Elle suppose des alliances nouvelles, des coalitions transversales, et une vision partagée du bien commun », selon Jonathan. « C’est par la coopération que viendra la résilience », pour Jérôme.
Volontés affichées de se tenir à l’écart des discours de façade, nos trois intervenants dessinent les contours d’un engagement incarné, pragmatique et courageux. Les tensions évoquées – entre conviction et performance, entre intention et résultat, entre local et global, entre nord et sud – montrent que la transformation est avant tout un chemin, semé d’embûches mais porteur de sens. Chacun d’eux incarne à sa manière cette exigence de cohérence : une parole claire, des actes alignés, une volonté d’embarquer les autres.
Jonathan souligne que les entreprises ont aujourd’hui un rôle politique de premier plan.
« Ce ne sont plus des entités neutres. Elles structurent nos modes de vie, nos imaginaires, nos futurs. À ce titre, elles doivent être à la hauteur. » Cette responsabilité croissante s’accompagne d’une attente de transparence et d’impact mesurable. Mais au-delà des chiffres, c’est une transformation culturelle qui est en jeu.
Jean rappelle à ce titre que le risque de greenwashing ne se combat pas uniquement par des labels ou du contrôle externe : « Il faut du courage managérial, de l’exemplarité et des preuves concrètes. » Il évoque l’importance de tester des solutions innovantes, d’analyser les apprentissages, et de cultiver une forme d’humilité collective dans l’action.
Jérôme garde une note de confiance lucide : « Il n’y aura pas de retour en arrière. Les entreprises qui ne changent pas sont condamnées à disparaître. Mais celles qui s’engagent vraiment ouvrent un champ des possibles immense. »

Trois intervenants engagés sur les chantiers de la transition écologique ont accepté d’échanger autour de ces enjeux. Sans langue de b...
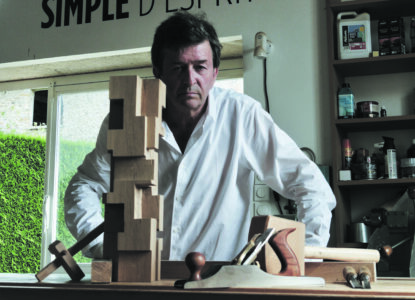
La parole pour terminer ce numéro spécial à un numéro tout à fait spécial de la pub des années 1990 à 2015, patron-co-fondateur de l...

Le 6 février dernier, notre table ronde consacrée aux entreprises familiales a réuni trois dirigeants qui nous ont partagé leurs parcour...